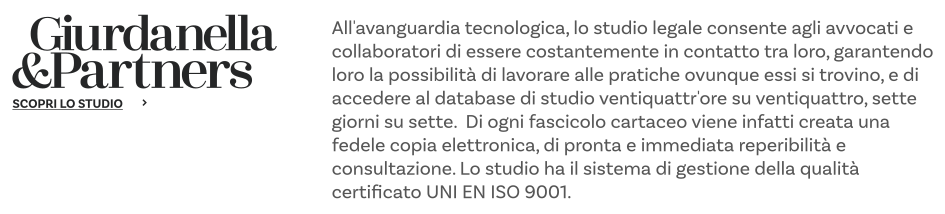La Corte Europea dei
diritti dell’uomo, con sentenza del 20 gennaio scorso, ha condannato l’Italia a risarcire i
costruttori di Punta Perotti, poichè la confisca dei terreni su cui
sorgeva il complesso edilizio abbattuto nel 2006, avrebbe violato la
Convenzione europea per i diritti dell’uomo e il diritto di
proprietà.
Punta Perotti, considerato uno degli ecomostri d’Italia, era stato costruito sul litorale barese nel
1995, dai gruppi imprenditoriali Andidero, Matarrese e Quistelli, a soli 300 metri dal mare.
Per questo, nel 1997, il gip di
Bari ne ordinò il sequestro. Ebbe così inizio una lunga battaglia
giudiziaria tra il Comune del capoluogo pugliese e le società
costruttrici (Sud Fondi, Iema e Mabar), nella quale una tappa
fondamentale è rappresentata dalla decisione della Corte di
Cassazione, che nel 2001, nonostante gli imputati fossero stati assolti, avendo edificato dopo avere ricevuto tutte le necessarie
autorizzazioni, dispose la confisca dei terreni e degli immobili, attribuendoli al Comune di Bari.
La Corte Europea, alla quale
hanno fatto ricorso le società costruttrici, ritenendo che al tempo in cui si
svolsero i fatti “le leggi in materia di confisca in Italia non
erano chiare e quindi non permettevano di prevedere l’eventuale
sanzione”, ha rilevato da parte dello Stato italiano una violazione
dell’art. 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo, poiché non può
essere inflitta una pena se non prevista dalla legge.
Inoltre, i
giudici di Strasburgo hanno constatato una violazione del diritto di
proprietà privata, costituendo la confisca illegale una lesione al
diritto dei ricorrenti di beneficiare della loro proprietà.
Al momento, il risarcimento
definito è di 40.000 euro, di cui 10.000 per danni morali e 30.000
per le spese giudiziarie, ma la Corte ha invitato il Governo italiano
a trovare un accordo con le società ricorrenti, che hanno richiesto
indennizzi ben più sostanziosi.
Di seguito, il testo integrale della decisione (in lingua francese).
. . . . . .
COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUD FONDI SRL ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 75909/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2009
(Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention).
En l’affaire Sud Fondi srl et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75909/01) dirigée contre la République italienne et dont trois sociétés basées dans cet Etat, Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 25 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Il ressort du dossier que la première requérante est en liquidation.
2. Les requérantes sont représentés par Me A. Giardina, Me Francesca Pietrangeli et Me Pasquale Medina, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
Mme E. Spatafora, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Les requérantes alléguaient en particulier que la confiscation dont elles ont fait l’objet est incompatible avec l’article 7 de la Convention et l’article 1 du Protocole no1.
4. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable. Le 30 août 2007, la Cour a déclaré recevable le restant de la requête.
5. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérantes, trois sociétés ayant leur siège à Bari, étaient propriétaires des constructions et terrains objets de la requête.
A. L’adoption des conventions de lotissement
7. La société Sud Fondi srl (infra « la première requérante ») était propriétaire d’un terrain sis à Bari, sur la côte de Punta Perotti, classé comme constructible par le plan général d’urbanisme (piano regolatore generale), et destiné à être utilisé dans le secteur tertiaire par les dispositions techniques du plan général d’urbanisme.
8. Par l’arrêté no 1042 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari approuva le projet de lotissement (piano di lottizzazione) présenté par cette société relativement à une partie de son terrain, dont la surface globale était de 58 410 mètres carrés. Ce projet – qui avait été pré-adopté le 20 mars 1990 – prévoyait la construction d’un complexe multifonctionnel, à savoir d’habitations, bureaux et magasins.
9. Le 3 novembre 1993, la première requérante et la Mairie de Bari conclurent une convention de lotissement ayant pour objet la construction d’un complexe de 199 327 mètres cubes ; en contrepartie la requérante céderait à la municipalité 36 571 mètres carrés dudit terrain.
10. Le 19 octobre 1995, l’administration municipale de Bari délivra le permis de construire.
11. Le 14 février 1996, la première requérante entama les travaux de construction, qui furent en grande partie terminés avant le 17 mars 1997.
12. Par l’arrêté no 1034 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari approuva un projet de lotissement (qui avait été pré-adopté le 20 mars 1990) concernant la construction d’un complexe multifonctionnel à réaliser sur un terrain de 41 885 mètres carrés classé comme constructible par le plan général d’urbanisme et limitrophe à celui de propriété de la société Sud Fondi srl. Les sociétés MABAR srl et IMCAR srl étaient propriétaires, respectivement, de 13 095 mètres carrés et 2 726 mètres carrés de ce terrain.
13. Le 1er décembre 1993, la société MABAR srl (infra « la deuxième requérante ») conclut avec l’administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d’habitations et bureaux pour 45 610 mètres cubes ; elle céderait à la municipalité 6 539 mètres carrés de terrain.
14. Le 3 octobre 1995, la Mairie de Bari délivra le permis de construire.
15. La deuxième requérante entama les travaux de construction ; il ressort du dossier qu’au 17 mars 1997, seules les fondations des bâtiments avaient été réalisées.
16. Le 21 juin 1993, la société IMCAR srl conclut avec l’administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d’un complexe de 9 150 mètres cubes, ainsi que la cession à la municipalité de 1 319 mètres carrés de terrain. Le 28 mars 1994, la société IMCAR srl vendit son terrain à la société IEMA srl.
17. Le 14 juillet 1995, la Mairie de Bari délivra à la société IEMA srl (infra « la troisième requérante ») un permis de construire des habitations, des bureaux et un hôtel.
18. La troisième requérante entama les travaux de construction. Il ressort du dossier qu’au 17 mars 1997, une partie du complexe avait été terminée.
19. Entre-temps, le 10 février 1997, l’autorité nationale pour la protection du paysage (Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali) s’était plainte auprès du maire de Bari de ce que les zones côtières soumises à une contrainte de paysage, telles qu’elles ressortaient des documents annexés au plan urbain de mise en œuvre, ne coïncidaient pas avec les zones marquées en rouge sur la planimétrie qui avait été transmise en 1984.
20. Il ressort du dossier qu’au moment de l’approbation des projets de lotissement litigieux, aucun plan urbain de mise en œuvre (piano di attuazione) du plan général d’urbanisme de Bari n’était en vigueur. En effet, le plan de mise en œuvre du 9 septembre 1986, en vigueur au moment de la pré-adoption des projets, avait expiré le 9 septembre 1991. Antérieurement, la ville de Bari avait élaboré un autre plan urbain de mise en œuvre, en vigueur du 29 décembre 1980 au 29 décembre 1985.
B. La procédure pénale
21. A la suite de la publication d’un article de presse concernant les travaux de construction effectués à proximité de la mer à « Punta Perotti », le 27 avril 1996, le procureur de la République de Bari ouvrit une enquête pénale.
22. Le 17 mars 1997, le procureur de la République ordonna la saisie conservatoire de l’ensemble des constructions litigieuses. Par ailleurs, il inscrivit dans le registre des personnes faisant l’objet de poursuites pénales les noms de Michele Matarrese Senior, Domenico Andidero et Antonio Quiselli, en tant que représentants respectifs des sociétés Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl, ainsi que les noms de trois autres personnes, en tant que directeurs et responsables des travaux de construction. Le procureur de la République estimait que la localité dénommée « Punta Perotti » était un site naturel protégé et que, par conséquent, l’édification du complexe était illégale.
23. Les requérantes attaquèrent la mesure de saisie conservatoire devant la Cour de cassation.
24. Par une décision du 17 novembre 1997, la Cour de cassation annula cette mesure et ordonna la restitution de l’ensemble des constructions aux propriétaires, au motif que le site n’était frappé d’aucune interdiction de bâtir par le plan d’urbanisme.
25. Par un jugement du 10 février 1999, le tribunal de Bari reconnut le caractère illégal des immeubles à « Punta Perotti » puisque non conformes à la loi no 431 de 1985 (« loi Galasso »), qui interdisait de délivrer des permis de construire relatifs aux sites d’intérêt naturel, parmi lesquelles figurent les zones côtières. Toutefois, vu qu’en l’espèce l’administration locale avait bien délivré les permis de construire, et vu la difficulté de coordination entre la loi no 431 de 1985 et la législation régionale, qui présentait des lacunes, le tribunal estima qu’il ne pouvait être reproché aux accusés ni faute ni intention. Par conséquent, le tribunal acquitta tous les accusés à défaut d’élément moral (« perché il fatto non costituisce reato »).
26. Dans ce même jugement, estimant que les projets de lotissement étaient matériellement contraires à la loi no 47 de 1985 et de nature illégale, le tribunal de Bari ordonna, aux termes de l’article 19 de cette loi, la confiscation de l’ensemble des terrains lotis à « Punta Perotti », ainsi que des immeubles y construits, et leur acquisition au patrimoine de la Mairie de Bari.
27. Par un arrêté du 30 juin 1999, le Ministre du Patrimoine (« Ministro dei beni culturali ») décréta une interdiction de construire dans la zone côtière près de la ville de Bari, y compris « Punta Perotti », au motif qu’il s’agissait d’un site de haut intérêt naturel. Cette mesure fut annulée par le tribunal administratif régional l’année suivante.
28. Le Procureur de la République interjeta appel du jugement du tribunal de Bari, demandant la condamnation des accusés.
29. Par un arrêt du 5 juin 2000, la cour d’appel réforma la décision de première instance. Elle estima que la délivrance des permis de construire était légale, en l’absence d’interdictions de bâtir à « Punta Perotti » et vu l’absence d’apparente illégalité dans la procédure d’adoption et approbation des conventions de lotissement.
30. Par conséquent, la cour d’appel acquitta les accusés au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut (« perché il fatto non sussiste ») et révoqua la mesure de confiscation de l’ensemble des constructions et terrains.
31. Le 27 octobre 2000, le Procureur de la République se pourvut en cassation.
32. Par un arrêt du 29 janvier 2001, déposé au greffe le 26 mars 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la décision de la cour d’appel. Elle reconnut l’illégalité matérielle des projets de lotissement, au motif que les terrains concernés était frappés d’une interdiction absolue de construire et d’une contrainte de paysage, imposées par la loi. A cet égard, la cour releva qu’au moment de l’adoption des projets de lotissement (le 20 mars 1990), la loi régionale no 30 de 1990 en matière de protection du paysage n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, les dispositions applicables en l’espèce étaient celles de la loi régionale no 56 de 1980 (en matière d’urbanisme) et la loi nationale no 431 de 1985 (en matière de protection du paysage).
33. Or, la loi no 56 de 1980 imposait une interdiction de construire au sens de l’article 51 F), à laquelle les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger. En effet, les projets de lotissement concernaient des terrains non situés dans l’agglomération urbaine. En outre, au moment de l’adoption des conventions de lotissement, les terrains concernés étaient inclus dans un plan urbain de mise en œuvre du plan général d’urbanisme qui était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi régionale no 56 de 1980.
34. Enfin, la Cour de cassation releva qu’en mars 1992, soit au moment de l’approbation des projets de lotissement, aucun programme urbain de mise en œuvre n’était en vigueur. A cet égard la Cour rappela sa jurisprudence selon laquelle il fallait qu’un plan urbain de mise en œuvre soit en vigueur au moment de l’approbation des projets de lotissement (Cour de cassation Section 3, 21.197, Volpe ; 9.6.97, Varvara ; 24.3.98, Lucifero). Ceci puisque – toujours selon la jurisprudence – une fois un plan urbain de mise en œuvre expiré, l’interdiction de construire à laquelle le programme avait mis fin redéployait ses effets. Par conséquent, il fallait retenir l’existence de l’interdiction de construire sur les terrains en cause, au moment de l’approbation des projets de lotissement.
35. La Cour de cassation retint également l’existence d’une contrainte de paysage au sens de l’article 1 de la loi nationale no 431 de 1985. En l’espèce, l’avis de conformité avec la protection du paysage de la part des autorités compétentes faisait défaut (à savoir il n’y avait ni le nulla osta délivré par les autorités nationales et attestant de la conformité avec la protection du paysage – au sens de l’article 28 de la loi no 1150/1942 – ni l’avis préalable des autorités régionales selon les articles 21 et 27 de la loi no 1150/1942 ou l’avis du comité régional pour l’urbanisme prévu aux articles 21 et 27 de la loi régionale no 56/1980).
36. Enfin, la Cour de cassation releva que les projets de lotissement ne concernaient que 41 885 mètres carrés, alors que, selon les dispositions techniques du plan général d’urbanisme de la ville de Bari, la surface minimale était fixée à 50 000 mètres carrés.
37. A la lumière de ces considérations, la Cour de cassation retint donc le caractère illégal des projets de lotissement et des permis de construire délivrés. Elle acquitta les accusés au motif qu’il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre les faits délictueux et qu’ils avaient commis une « erreur inévitable et excusable » dans l’interprétation de dispositions régionales « obscures et mal formulées » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit également en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l’obtention des permis de construire, les requérantes avaient été rassurés par le directeur du bureau communal compétent ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles le projet de construction se heurtait ne figuraient pas dans le plan d’urbanisme ; que l’administration nationale compétente n’était pas intervenue. Enfin, la Cour de cassation affirma qu’en l’absence d’une enquête portant sur les raisons des comportements tenus par les organes publics, il n’était pas permis de faire des suppositions.
38. Par le même arrêt, la Cour de cassation ordonna la confiscation de l’ensemble des constructions et des terrains, au motif que, conformément à sa jurisprudence, l’application de l’article 19 de la loi no 47 de 1985 était obligatoire en cas de lotissement illégal, même en l’absence d’une condamnation pénale des constructeurs.
C. Les développements postérieurs à l’issue de la procédure pénale
39. Le 23 avril 2001, l’administration municipale communiqua aux requérantes qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001, la propriété des terrains dédites sociétés sis à « Punta Perotti » avait été transférée à la municipalité.
40. Le 27 juin 2001, l’administration municipale de Bari procéda à l’occupation matérielle des terrains.
41. Des tiers dont les terrains étaient concernés par le projet de lotissement se virent également privés des terrains par l’effet de la confiscation.
42. Les requérantes, ainsi que des tiers qui n’avaient jamais fait l’objet de poursuite pénale, introduisirent un recours en opposition pour tenter de bloquer l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation pénale, qui avait ordonné la confiscation. Le recours des requérantes fut rejeté par le tribunal de Bari et puis par la Cour de cassation le 27 janvier 2005. L’État introduisit également un recours en opposition pour éviter que des biens lui appartenant ne soient confisqués au bénéfice de la ville de Bari. Par une décision du 9 mai 2005, la Cour de cassation rejeta le recours, au motif que la confiscation devait frapper toute la zone concernée par le projet de lotissement, y compris les lots non construits et les lots qui n’avaient pas encore été vendus, étant donné que tous ces terrains avaient perdu leur vocation et destination d’origine à cause du projet de lotissement litigieux.
43. En avril 2006 les immeubles érigés par les requérantes furent démolis.
44. Entre-temps, le 28 janvier 2006, Sud Fondi avait saisi le tribunal civil de Bari d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre le Ministère des biens culturels, la région des Pouilles et la ville de Bari, autorités auxquelles elle reprochait pour l’essentiel d’avoir accordé des permis de construire sans la diligence requise et d’avoir garanti que tout le dossier était conforme à la loi. La requérante demandait 150 000 000 EUR correspondant à la valeur actuelle du terrain confisqué, plus 134 530 910,69 EUR pour dommage ultérieur, 152 332 517,44 EUR pour manque à gagner et 25 822 844,95 EUR pour dommage immatériel. En outre, ses associés (Matarrese) demandaient un dédommagement pour atteinte à leur réputation.
45. Les parties ont indiqué que MABAR a intenté une procédure séparée pour demander les dommages à l’égard des mêmes autorités, et que IEMA n’a pas saisi les tribunaux nationaux, elle s’est bornée à envoyer un courrier aux autorités concernés.
46. Les 28 mars, 7 avril et 7 juin 2006, les requérantes ont déposé des articles de presse portant sur la démolition des bâtiments et mentionnant une procédure en dommages-intérêts intentée par la famille Matarrese. En particulier, un article paru le 26 avril 2006 dans La Stampa informait les lecteurs qu’une demande en dommages-intérêts à concurrence de 570 millions d’euros avait été adressée à la ville de Bari et que celle-ci avait répliqué en demandant en dédommagement à concurrence de 105 millions d’euros pour atteinte à l’image de la ville.
47. Le 10 mars 2008, le Gouvernement a transmis un article de presse, paru à une date non précisée, duquel il ressort qu’après la décision sur la recevabilité, la Cour a invité les parties à trouver un accord amiable ou à lui soumettre une demande en dommages-intérêts. L’article indique que « si Matarrese (Sud Fondi) semble avoir l’intention de réclamer quelques centaines de millions d’euros, le Gouvernement n’entend même pas faire une proposition (……). L’article indique ensuite : « Nous ne donnerons aucun euro et nous n’adhérons pas à la proposition » et puis : La défense du Gouvernement à Strasbourg (c’est un magistrat) se plaint de ne pas avoir reçu toute la documentation sur l’affaire (…). En particulier, la nouvelle qu’une procédure en dommages-intérêts au plan national avait été intentée ne lui serait pas parvenue. Autrement, cette nouvelle aurait pu amener la Cour à décider autrement sur la recevabilité de la requête.
48. Le 9 avril 2008, dans le cadre d’un procès pénal ne concernant pas les requérantes, la cour d’appel de Bari – ayant pris bonne note de ce que la présente requête avait été déclarée recevable par la Cour – a saisi la Cour constitutionnelle pour que celle-ci se prononce sur la légalité de la confiscation infligée automatiquement même dans le cas ou aucune responsabilité pénale n’a été constatée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions permettant d’apprécier le caractère abusif du lotissement
La loi no 1497 de 1939
49. La protection des lieux pouvant être considérés comme sites naturels remarquables (bellezze naturali) est réglementée par la loi no 1497 du 29 juin 1939, qui prévoit le droit de l’Etat d’imposer une « contrainte de paysage » (vincolo paesaggistico) sur les sites à protéger.
Le Décret du Président de la République no 616 de 1977
50. Par le Décret du Président de la République, DPR no 616 du 1977, l’Etat a délégué aux Régions les fonctions administratives en matière de protection des sites naturels remarquables.
La loi no 431 de 8 août 1985 (Dispositions urgentes en matière des sites présentant un grand intérêt pour l’environnement).
51. L’article 1 de cette loi soumet à des « limitations visant à protéger le paysage et l’environnement au sens de la loi no 1497 de 1939 (vincolo paesaggistico ed ambientale), entre autres, les zones côtières situées à moins de 300 mètres de la ligne de brisement des vagues, même pour les terrains surplombant la mer. »
Il en découle l’obligation de demander aux autorités compétentes un avis de conformité avec la protection du paysage de tout projet de modification des lieux.
« Ces limitations ne s’appliquent pas aux terrains inclus dans les « zones urbaines A et B ». Pour les terrains inclus dans d’autres zones, ces limitations ne s’appliquent pas à ceux qui sont inclus dans un plan urbain de mise en œuvre. »
Par cette loi, le législateur a soumis le territoire à une protection généralisée. Celui qui ne respecte pas les contraintes prévues à l’article 1, est puni notamment aux termes de l’article 20 de la loi no 47 de 1985 (sanctions prévues en matière d’urbanisme, voir infra).
La loi no 10 du 27 janvier 1977 (Dispositions en matière de constructibilité des sols)
52. La loi no 10 du 27 janvier 1977 prévoit à l’article 13 que les plans généraux d’urbanisme peuvent être réalisés à condition qu’un plan ou un programme urbain de mise en œuvre (piano o programma di attuazione) existe. Ce programme de mise en œuvre doit délimiter les zones dans lesquelles les dispositions des plans généraux d’urbanisme doivent être mises en œuvre.
Il incombe aux Régions de décider du contenu et de la procédure permettant d’aboutir à un plan urbain de mise en œuvre et d’établir la liste des villes exonérées de l’obligation d’adopter un plan de mise en œuvre.
Lorsqu’une ville est obligée d’adopter un plan de mise en œuvre, les permis de construire ne peuvent être délivrés par le maire que si les permis litigieux ne visent une zone incluse dans le programme de réalisation (sauf exceptions prévues par la loi) et que si le projet est conforme au plan général d’urbanisme.
Aux termes de l’article 9, les villes exonérées de l’obligation d’adopter un plan de mise en œuvre peuvent délivrer des permis de construire.
La loi de la Région des Pouilles no 56 du 31 mai 1980
53. La loi régionale no 56 du 31 mai 1980, à son article 51 alinéa f), dispose :
« … Jusqu’à l’entrée en vigueur des plans d’urbanisme territoriaux…
F) Il est interdit de construire à moins de 300 mètres de la limite avec le domaine maritime1 ou du point le plus élevé surplombant la mer.
En cas de plan d’urbanisme (strumento urbanistico) déjà en vigueur ou adopté au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, il est possible de construire seulement dans les zones A, B et C au sein des centres habités et au sein des installations touristiques. En outre, il est possible de construire des ouvrages publics et d’achever des installations industrielles et artisanales qui étaient en cours de construction à l’entrée en vigueur de cette loi »
L’article 18 de la loi no 47 de 1985
54. La loi no 47 du 27 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle de l’activité urbaine et de construction, sanctions, récupération et régularisation des ouvrages) définit le « lotissement abusif » à son article 18 :
« Il y a lotissement abusif d’un terrain en vue de la construction,
a) en cas de commencement d’ouvrages impliquant une transformation urbaine non conforme aux plans d’urbanisme (strumenti urbanistici), déjà en vigueur ou adoptés, ou en tout cas non conforme aux lois de l’Etat ou des Régions ou bien en l’absence de l’autorisation requise ; (…) »
55. Cette disposition a été interprétée dans un premier temps dans le sens d’exclure le caractère abusif d’un lotissement lorsque les autorités compétentes ont délivré les permis requis (Cour de cassation, Section 3, arrêt no 6094/1991, Ligresti ; 18 octobre 1988, Brulotti).
Elle a ensuite été interprétée dans le sens que, même s’il est autorisé par les autorités compétentes, un lotissement non conforme aux dispositions urbaines en vigueur est abusif (voir l’arrêt de la Cour de cassation du cas d’espèce, précédé par Cour de cassation, section 3, 16 novembre 1995, Pellicani, et 13 mars 1987, Ginevoli ; confirmé par le Sections Réunies de la Cour de cassation, arrêt no 5115 de 2002, Spiga).
B. La confiscation
Principes généraux de droit pénal
56. a) L’article 27 § 1 de la Constitution italienne prévoit que « la responsabilité pénale est personnelle ». La Cour constitutionnelle a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne peut y avoir de responsabilité objective en matière pénale (voir, parmi d’autres, Cour constitutionnelle, arrêt no 1 du 10 janvier 1997, et infra, « autres cas de confiscation ». L’article 27 § 3 de la Constitution prévoit que « les peines …doivent tendre à la rééducation du condamné ».
b) L’article 25 de la Constitution prévoit, à ses deuxième et troisième alinéas, que « personne ne peut être puni en l’absence d’une loi entrée en vigueur avant la commission des faits » et que « personne ne peut être sujette à une mesure de sureté sauf dans les cas prévus par la loi ».
c) L’article 1 du code pénal prévoit que « personne ne peut être puni pour un fait qui n’est pas expressément prévu par la loi comme étant constitutif d’une infraction pénale, et avec une peine qui n’est pas établie par la loi ». L’article 199 du code pénal, concernant les mesures de sureté, prévoit que personne ne peut être soumis à des mesures de sûreté non prévues par la loi et en dehors des cas prévus par la loi.
d) L’article 42, 1er alinéa du code pénal prévoit que « l’on ne peut être puni pour une action ou une omission constituant une infraction pénale prévue par la loi si, dans la commission des faits, l’auteur n’avait pas de conscience et volonté (coscienza e volontà) ». La même règle est établie par l’article 3 de la loi du 25 novembre 1989 no 689 en ce qui concerne les infractions administratives.
e) L’article 5 du code pénal prévoit que « Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pénale pour obtenir une excuse ». La Cour constitutionnelle (arrêt n.364 de 1988) a statué que ce principe ne s’applique pas quand il s’agit d’une erreur inévitable, de sorte que cet article doit désormais être lu comme suit : « Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pénale pour obtenir une excuse, sauf s’il s’agit d’une erreur inévitable ». La Cour constitutionnelle a indiqué comme possible origine de l’inévitabilité objective de l’erreur sur la loi pénale l’ « obscurité absolue de la loi », les « assurances erronées » de la part de personnes en position institutionnelle pour juger de la légalité des faits à accomplir, l’état « gravement chaotique » de la jurisprudence.
La confiscation prévue par le code pénal
57. Aux termes de l’article 240 du code pénal :
« 1er alinéa : En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des choses qui ont servi ou qui furent destinées à la commission de l’infraction, ainsi que les choses qui sont le produit ou le bénéfice de l’infraction.
2ème alinéa : La confiscation est toujours ordonnée :
1. Pour les choses qui constituent le prix de l’infraction ;
2. Pour les choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation sont pénalement interdites.
3ème alinéa : Dans les cas prévus au premier alinéa et au point 1 du deuxième alinéa, la confiscation ne peut frapper les tiers (« personnes étrangères à l’infraction ») propriétaires des choses en question.
4ème alinéa : Dans le cas prévu au point 2 du deuxième alinéa, la confiscation ne peut frapper les tiers (« personnes étrangères à l’infraction ») propriétaires lorsque la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation peuvent être autorisés par le biais d’une autorisation administrative. »
58. En tant que mesure de sûreté, la confiscation relève de l’article 199 du code pénal qui prévoit que « personne ne peut être soumis à des mesures de sûreté non prévues par la loi et en dehors des cas prévus par la loi ».
Autres cas de confiscation / La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
59. En matière de douanes et de contrebande, les dispositions applicables prévoient la possibilité de confisquer des biens matériellement illicites, même si ces derniers sont détenus par des tiers. Par l’arrêt no 229 de 1974, la Cour constitutionnelle a déclaré les dispositions pertinentes incompatibles avec la Constitution (notamment l’article 27), sur la base du raisonnement suivant :
« Il peut y avoir des choses matériellement illicites, dont le caractère illicite ne dépend pas de la relation avec la personne qui en dispose. Ces choses doivent être confisquées auprès toute personne les détenant à n’importe quel titre (… ).
Pour éviter que la confiscation obligatoire des choses appartenant à des tiers -étrangers à la contrebande – ne se traduise en une responsabilité objective à leur charge – à savoir une responsabilité du simple fait qu’ils sont propriétaires des choses impliquées – et pour éviter qu’ils subissent les conséquences patrimoniales des actes illicites commis par d’autres, il faut que l’on puisse reprocher à ces tiers un quid sans lequel l’infraction (…) n’aurait pas eu lieu ou n’aurait pas été favorisée. En somme, il faut pouvoir reprocher à ces tiers un manque de vigilance. »
60. La Cour constitutionnelle a réitéré ce principe dans les arrêts no 1 de 1997 et no 2 de 1987, en matière de douanes et d’exportation d’œuvres d’art.
La confiscation du cas d’espèce (article 19 de la loi no 47 du 28 février 1985)
61. L’article 19 de la loi no 47 du 28 février 1985 prévoit la confiscation des ouvrages abusifs aussi bien que des terrains lotis de manière abusive, lorsque les juridictions pénales ont établi par un arrêt définitif que le lotissement est abusif. L’arrêt pénal est immédiatement transcrit dans les registres immobiliers.
L’article 20 de la loi no 47 du 28 février 1985
62. Cette disposition prévoit des sanctions définies comme étant des « sanctions pénales ». La confiscation n’y figure pas.
En cas de lotissement abusif – tel que défini à l’article 18 de cette même loi – les sanctions prévues sont l’emprisonnement jusqu’à deux ans et l’amende jusqu’à 100 millions de lires italiennes (environ 516 460 euros).
L’article 44 du code de la construction (DPR no 380 de 2001)
63. Le Décret de Président de la République no 380 du 6 juin 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative et regolamentari in materia edilizia) a codifié les dispositions existantes notamment en matière de droit de bâtir. Au moment de la codification, les articles 19 et 20 de la loi no 47 de 1985 ci-dessus ont été unifiés en une seule disposition, à savoir l’article 44 du code, qui est ainsi titré :
« Art. 44 (L) – Sanctions pénales
(…)
2. La confiscation des ouvrages abusifs aussi bien que des terrains lotis de manière abusive, lorsque les juridictions pénales ont établi par un arrêt définitif que le lotissement est illégal. »
La jurisprudence relative à la confiscation pour lotissement abusif
64. Dans un premier temps, les juridictions nationales avaient classé la confiscation applicable en cas de lotissement abusif comme étant une sanction pénale. Dès lors, elle ne pouvait être appliquée qu’aux biens du prévenu reconnu coupable du délit de lotissement illégal, conformément à l’article 240 du code pénal (Cour de cassation, Sec. 3, 18 octobre 1988, Brunotti ; 8 mai 1991, Ligresti ; Sections Unies, 3 février 1990, Cancilleri).
65. Par un arrêt du 12 novembre 1990, la Section 3 de la Cour de cassation (affaire Licastro) affirma que la confiscation était une sanction administrative et obligatoire, indépendante de la condamnation au pénal. Elle pouvait donc être prononcée à l’égard de tiers, puisqu’à l’origine de la confiscation il y a une situation (une construction, un lotissement) qui doit être matériellement abusive, indépendamment de l’élément moral. De ce fait, la confiscation peut être ordonnée lorsque l’auteur est acquitté en raison de l’absence d’élément moral (« perché il fatto non costituisce reato »). Elle ne peut pas être ordonnée si l’auteur est acquitté en raison de la non matérialité des faits (« perché il fatto non sussiste »).
66. Cette jurisprudence fut largement suivie (Cour de Cassation, Section 3, arrêt du 16 novembre 1995, Besana ; no 12471, no 1880 du 25 juin 1999, Negro ; 15 mai 1997 no 331, Sucato ; 23 décembre 1997 no 3900, Farano ; no 777 du 6 mai 1999, Iacoangeli). Par l’ordonnance no 187 de 1998, la Cour constitutionnelle a reconnu la nature administrative de la confiscation.
Tout en étant considérée comme étant une sanction administrative par la jurisprudence, la confiscation ne peut être annulée par un juge administratif, la compétence en la matière relevant uniquement du juge pénal (Cour de cassation, Sec. 3, arrêt 10 novembre 1995, Zandomenighi).
La confiscation de biens se justifie puisque ceux-ci sont les « objets matériels de l’infraction ». En tant que tels, les terrains ne sont pas « dangereux », mais ils le deviennent lorsqu’ils mettent en danger le pouvoir de décision qui est réservé à l’autorité administrative (Cour de cassation, Sec. 3, no 1298/2000, Petrachi et autres).
Si l’administration régularise ex post le lotissement, la confiscation doit être révoquée (Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2000 no 12999, Lanza ; 21 janvier 2002, no 1966, Venuti).
Le but de la confiscation est de rendre indisponible une chose dont on présume qu’on connaît la dangerosité : les terrains faisant l’objet d’un lotissement abusif et les immeuble abusivement construits. On évite ainsi la mise sur le marché immobilier de tels immeubles. Quant aux terrains, on évite la commission d’infractions ultérieures et on ne laisse pas de place à des pressions éventuelles sur les administrateurs locaux afin qu’ils régularisent la situation (Cour de cassation, Sec. 3, 8 février 2002, Montalto).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
67. Dans ses observations du 5 décembre 2007, le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il aurait appris grâce à des articles de presse que Sud Fondi et MABAR, avant la décision sur la recevabilité, avaient engagé une procédure en dommages-intérêts au niveau national à l’encontre de la ville de Bari, de la région Pouilles et de l’Etat. Le Gouvernement a précisé que la requérante IEMA n’avait pas intenté de recours et qu’elle avait sommé l’administration publique de la dédommager à concurrence de 47 millions d’euros. D’après le Gouvernement, les procédures engagées sont identiques à celle intentée à Strasbourg tant pour le petitum que pour la causa petendi. La Cour devrait dès lors rayer la requête du rôle ou la déclarer irrecevable.
68. Le Gouvernement observe ensuite que « les requérantes sont porteuses de plusieurs vérités », car au niveau européen, elles revendiquent leur droit de bâtir alors qu’au niveau national elles admettent d’avoir commis une erreur causée par le comportement de l’administration. Il en découle que les requérantes demandent la déclaration de la responsabilité de l’Etat italien pour des motifs contradictoires entre eux devant la Cour et devant les juges nationaux.
69. Le 14 janvier 2008, le Gouvernent a dénoncé un abus de procédure des requérantes au motif que celles-ci n’avaient pas informé la Cour de ce qu’elles avaient réclamé des dommages-intérêts au niveau national. Elles auraien voulu cacher ces informations à la Cour, ce qui ne se concilie pas avec l’article 47 § 6 du Règlement de la Cour, d’après lequel les parties doivent informer cette dernière de tout fait pertinent pour l’examen de l’affaire. Vu que les requérantes ont transmis des communications incomplètes et donc trompeuses, la Cour devrait rayer la requête du rôle ou la déclarer irrecevable car abusive. Il se réfère sur ce point à l’affaire Hadrabova et autres c. République tchèque (déc.), 25 septembre 2007.
70. Le 10 mars 2008, le Gouvernement a dénoncé un deuxième abus des requérantes relatif à un article de presse (voir paragraphe 47 ci-dessus) publié à une date non connue. Selon lui, cet article révèle le non-respect de la confidentialité de la procédure de la part des requérantes et confirme le caractère abusif de la requête.
71. Les requérantes s’opposent aux arguments du Gouvernement.
72. S’agissant de l’exception de non-épuisement, elles observent que celle-ci est tardive, car le Gouvernement ne pouvait pas ignorer l’existence de ces procédures bien avant la décision sur la recevabilité vu que Sud Fondi et MABAR ont assigné en justice des organismes publics (la ville de Bari, le ministère des biens culturels et la région des Pouilles) en date du 28 janvier 2006. L’État a déposé un mémoire de constitution en réponse
le 18 avril 2006. Ce n’est donc pas sérieux de la part du Gouvernement de soutenir qu’il n’était pas au courant de ces procédures avant la recevabilité. Par conséquent, elles demandent à la Cour de rejeter cette exception, vu qu’elle n’a été soulevée que le 5 décembre 2007. En tout état de cause, les requérantes observent que IEMA n’a pas intenté de recours et n’est donc pas concernée par cette exception.
73. En outre, les requérantes observent que le Gouvernement n’a pas montré l’accessibilité et efficacité des recours intentés par rapport aux violations alléguées. Elles soutiennent que la possibilité d’intenter un recours en dommages-intérêts comme elles l’ont fait n’existe que depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 204 de 2004. L’accès à ce remède étant inexistant au moment de l’introduction de la requête, ce remède n’est pas à épuiser. En outre, les requérantes ayant déjà épuisé la voie pénale, un recours civil n’est pas à épuiser. Ensuite, elles observent que les arguments soutenus par le Gouvernement devant le tribunal civil de Bari, à savoir l’absence de juridiction et la prescription du droit à réparation, ne se concilient pas avec l’argument soulevé devant la Cour, selon lequel le recours intenté est efficace et donc à épuiser. Enfin, les recours engagés au niveau national ne visent pas à doubler le recours engagé à Strasbourg car ils ne concernent pas la procédure pénale s’étant terminée par la confiscation des biens, et donc ne visent pas la réparation des violations de la Convention. Les recours nationaux se fondent sur la responsabilité extracontractuelle des administrations pour avoir pendant de longues années certifié la nature constructible des terrains en cause et pour avoir délivré des permis de construire.
74. Quant au prétendu caractère abusif de la requête, les requérantes observent que dans l’affaire Hadrabova citée par le Gouvernement, la partie requérante avait déjà obtenu au plan national un dédommagement pour le même motif invoqué devant la Cour et elle l’avait caché. Or, en l’espèce aucun dédommagement n’a été payé par l’État italien. En outre, les informations passées sous silence dans l’affaire Hadrabova concernaient l’existence d’une procédure ayant le même objet que celle pendante à Strasbourg, alors qu’en l’espèce il s’agit de deux procédures différentes. En outre, les requérantes observent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de cacher à la Cour l’existence de ces procédures, dont, par ailleurs, il était fait mention dans les articles de presse qu’elles ont envoyés à la Cour. Tout simplement, vu que le but des procédures nationales n’est pas le même que celui de la procédure à Strasbourg, elles n’estimaient pas nécessaire d’envoyer un courrier ad hoc.
75. Quant à la prétendue divulgation d’informations confidentielles, les requérantes nient d’avoir fait de révélations à la presse concernant le fait que le Gouvernement avait refusé le règlement amiable, vu que le refus ne leur avait pas été notifié par les autorités italiennes. En tout état de cause, elles observent que les informations qui se trouvent dans la presse ne sont pas sous leur contrôle.
76. Enfin, les requérantes tiennent à critiquer la teneur de certains passages des observations du Gouvernement (paragraphes 97, 145 et 159
ci-dessous), qu’elles qualifient d’offensantes. Elles tiennent à souligner leur bonne foi, tant dans la procédure à Strasbourg qu’au niveau national.
77. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 55 de son règlement,
« Si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (…) ».
78. En l’espèce, la Cour estime qu’avant la décision sur la recevabilité du 30 août 2007, le Gouvernement ne pouvait pas ignorer les demandes en dommages-intérêts des requérantes dûment notifiées en 2006 à l’encontre d’organismes publics, dont le Ministère des biens culturels. Il y a donc forclusion pour ce qui est des exceptions ayant trait aux procédures en dommages-intérêts intentées au niveau national.
79. La Cour rappelle ensuite qu’elle peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable « à tout moment de la procédure » (article 35 § 4 de la Convention). Des faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent la conduire, même au stade de l’examen du fond, à revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable et à la déclarer ultérieurement irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention (voir, par exemple, Medeanu c. Roumanie (déc.), no 29958/96, du 8 avril 2003 ; İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII ; Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, §§ 37-43, CEDH 2004-III). Elle peut aussi rechercher, même à un stade avancé de la procédure, si la requête se prête à l’application de l’article 37 de la Convention. Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour doit examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant tire directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation),
no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
80. En l’espèce, la Cour ne relève pas l’existence d’un « fait nouveau » survenu après la recevabilité qui pourrait l’amener à revenir sur sa décision quant à la recevabilité. En outre, elle note que le litige n’a pas été résolu de sorte qu’il n’y a pas lieu de rayer la requête du rôle.
81. La Cour rappelle enfin qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive si elle a été fondée sciemment sur des faits erronés (voir, entre autres, Kérétchavili c. Géorgie, no 5667/02, 2 mai 2006 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 37, CEDH 2000-X ; Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; Řehàk c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004), en vue d’induire délibérément la Cour en erreur (Assenov et autres c. Bulgarie, décision de la Commission, no 24760/94, 27 juin 1996 ; Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X).
82. La Cour, tout en regrettant que les requérantes n’aient pas formellement informé la Cour de leurs démarches auprès des tribunaux internes, ne considère pas établi qu’elles aient essayé de l’induire en erreur. La requête n’est donc pas abusive.
83. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
84. Les requérantes dénoncent l’illégalité de la confiscation qui a frappé leurs biens au motif que cette sanction aurait été infligée dans un cas non prévu par la loi. Elles allèguent la violation de l’article 7 de la Convention, qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
A. Sur l’applicabilité de l’article 7 de la Convention
85. La Cour rappelle que, dans sa décision du 30 août 2007, elle a estimé que la confiscation litigieuse s’analyse en une peine et que, partant, l’article 7 de la Convention trouve à s’appliquer.
B. Sur l’observation de l’article 7 de la Convention
1. Arguments des requérantes
86. Les requérantes soutiennent que le caractère abusif du lotissement n’était pas « prévu par la loi ». Leurs doutes quant à l’accessibilité et à la prévisibilité des dispositions applicables seraient confirmés par l’arrêt de la Cour de cassation, ayant constaté que les accusés s’étaient trouvés dans une situations de « ignorance inévitable » ; ceux-ci ont été acquittés pour l’« erreur excusable » commise dans l’interprétation du droit applicable, compte tenu de la législation régionale obscure, de l’obtention des permis de construire, des assurances reçues de la part des autorités locales quant à la régularité de leurs projets et de l’inertie des autorités compétentes en matière de protection du paysage jusqu’en 1997. Sur le point de savoir si, une fois tous les permis de construire accordés, un lotissement pouvait être ou non qualifié d’abusif, la jurisprudence a en outre connu beaucoup d’hésitations qui n’ont été résolues que le 8 février 2002, par les Sections Réunies de la Cour de cassation. Ceci prouve donc que jusqu’en 2001 il y avait incertitude et que le fait d’avoir qualifié d’abusif le lotissement des requérantes, antérieurement au prononcé à sections réunies, constitue une interprétation non littérale, extensive, et donc imprévisible et incompatible avec l’article 7 de la Convention.
87. Les requérantes soutiennent ensuite qu’il n’y avait en tout cas pas d’illégalité matérielle en l’espèce, puisque les lotissements ne se heurtaient pas à des limitations frappant leurs terrains. Sur ce point, elles se réfèrent à l’arrêt de la cour d’appel de Bari, qui n’avait constaté aucune illégalité matérielle, estimant qu’aucune interdiction de construire ne frappait les terrains en cause. En outre, au fait que le ministère des biens culturels ait pris un arrêté le 30 juin 1999 soumettant les terrains en cause à des contraintes prouverait qu’antérieurement, aucune contrainte ne gravait sur lesdits terrains. Enfin, le plan d’urbanisme « territorial thématique du paysage », adopté le 15 décembre 2000 par décision du conseil régional des Pouilles no 1748, confirmerait qu’il n’y avait aucune interdiction de bâtir.
88. S’agissant de la légalité de la sanction qui leur a été infligée, les requérantes soutiennent que, pour être légale, une peine doit être prévisible, à savoir il doit être possible de prévoir raisonnablement au moment de la commission de l’infraction les conséquences y afférentes au niveau de la sanction, aussi bien en ce qui concerne le type de sanction que la mesure de la sanction. En outre, pour être compatible avec l’article 7 de la Convention, une peine doit se rattacher à un comportement reprochable. Les requérantes estiment qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
89. Au moment où les permis de construire ont été délivrés, et à l’époque de la construction des bâtiments, il était impossible pour les requérantes de prévoir l’application de la confiscation. En effet, la loi no 47 de 1985 ne prévoyant pas de manière explicite la possibilité de confisquer les biens de tiers en cas d’acquittement des accusés, la confiscation infligée dans le cas d’espèce serait « non prévue par la loi ». Pour infliger la confiscation, les juridictions nationales ont donné une interprétation non littérale de l’article 19 de la loi no 47/1985 et ceci est arbitraire puisqu’on est dans le domaine pénal et l’interprétation par analogie au détriment de l’intéressé ne peut pas être utilisée. En outre, une telle interprétation se heurte à l’article 240 du code pénal, qui établit le régime général des confiscations.
90. Même à supposer que l’interprétation ayant conduit à confisquer les biens d’une personne acquittée puisse être qualifiée d’interprétation littérale, il faut néanmoins encore démontrer que le caractère abusif du lotissement était effectivement prévu par la loi. Sur ce point, les requérantes rappellent que le caractère abusif du lotissement en question était loin d’être manifeste, vu l’acquittement au motif que la législation était tellement complexe que l’ignorance de la loi était inévitable et excusable.
91. Les requérantes observent ensuite que la sanction ne se rattache pas à un comportement reprochable, vu que la confiscation a été ordonnée à elles qui sont « tierces » par rapport aux accusés et compte tenu surtout de l’acquittement de ceux-ci et des motivations de l’acquittement. Les requérantes invoquent à cet égard le principe de la « responsabilité pénale personnelle » prévu par la Constitution, ce qui interdit de répondre pénalement du fait d’autrui. Ce principe n’est qu’un aspect complémentaire de l’interdiction de l’analogie in malam partem et de l’obligation d’énumérer de manière limitative les cas auxquels une sanction pénale s’applique (principio di tassatività).
92. Les requérantes rappellent enfin que, jusqu’en 1990, la confiscation avait été classée par les juridictions nationales parmi les sanctions pénales. De ce fait, elle pouvait frapper uniquement les biens de l’accusé (Cour de cassation, Section 3, 16 novembre 1995, Befana; 24 février 1999, Iacoangeli). Ce n’est qu’à partir de 1990 que la jurisprudence a évolué dans le sens de considérer la confiscation comme étant une sanction administrative et donc pouvant s’infliger indépendamment de la condamnation pénale et aussi à l’égard de tiers. Selon elles, un tel revirement de jurisprudence a eu lieu uniquement pour permettre la confiscation des biens de tiers en cas d’acquittement des accusés, comme en l’espèce.
93. Enfin, les requérantes observent que l’Etat soutient devant la Cour une thèse différente par rapport à celle soutenue au niveau national par les avocats ayant assumé la défense de la Région des Pouilles et de l’automobile club italien, qui a contesté la légalité de la confiscation à leur égard car infligée à des sujets étrangers à la procédure pénale.
94. En conclusion, la confiscation de l’espèce se heurte à l’interdiction de la responsabilité pénale pour fait d’autrui et est dès lors arbitraire.
95. De surcroît, les requérantes rappellent la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle une confiscation ne peut frapper les biens des tiers étrangers à l’infraction que « lorsqu’à ceux-ci l’on peut reprocher un quid sans lequel l’infraction n’aurait pas eu lieu ou n’aurait pas été favorisée ». Ensuite, les requérantes invoquent le principe selon lequel une personne morale ne peut pas être pénalement responsable (societas delinquere non potest).
2. Arguments du Gouvernement
96. Le Gouvernement soutient que tant l’infraction que la confiscation étaient « prévues par la loi », à savoir par des dispositions accessibles et prévisibles. Aucun problème de rétroactivité ni d’interprétation extensive ne se pose en l’espèce.
97. Il y avait illégalité matérielle, car les terrains litigieux étaient frappés par les limitations ex lege, prévues, d’une part, par l’article 51 f) de la loi régionale no 56 de 1980 et, d’autre part, par la loi no 431 de 1985 en vigueur depuis le 15 septembre 1985. Ces contraintes existaient avant l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 déclarant certaines parties du territoire de la ville de Bari comme étant d’intérêt remarquable pour le paysage. Elles étaient accessibles et prévisibles, car publiées. Elles devaient être claires pour les requérantes, vu qu’elles ne sont pas assimilables à un citadin quelconque mais sont des professionnels de la construction et donc une diligence spéciale pouvait être attendue d’elles (Chorherr c. Autriche,
25 août 1993, § 25, série A no 266-B ; Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 60, série A no 246-A). Le Gouvernement admet que l’administration s’est conduite comme si tout était dans l’ordre. Cependant, le comportement de celle-ci n’aurait pas été transparent et conforme aux normes de bonne administration.
98. S’agissant de la confiscation, celle-ci est prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985. Cette disposition était accessible et prévisible.
99. Quant à l’interprétation de cette disposition par les juridictions nationales, selon le Gouvernement elle n’a pas été extensive au détriment des requérantes. En l’espèce, l’interprétation judiciaire a été cohérente avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (sur ce point le Gouvernement se réfère notamment à S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 36, série A no 335-B ; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 82, CEDH 2001-II). A cet égard, le Gouvernement observe que l’article 19 de la loi no 47 de 1985 n’exige pas la condamnation de l’auteur de l’infraction, mais seulement le constat du caractère illégal du lotissement. Si le législateur national avait voulu prévoir la confiscation seulement dans le cas d’un prévenu condamné, dans le texte de l’article 19 de la loi no 47/1985 après le mot « décision » il y aurait le mot « condamnation ». Le fait que cette disposition ne spécifie pas que la confiscation peut avoir lieu uniquement en cas de condamnation permet au juge pénal d’ordonner la confiscation dans le cas d’un acquittement où il a tout de même constaté le caractère matériellement illégal d’un lotissement. Il s’agit en effet d’une sanction réelle et non personnelle. Il est donc possible de confisquer dans le cas d’un acquittement comme celui de l’espèce, où l’élément moral fait défaut. En conclusion, il y a eu interprétation littérale de la loi, car en l’espèce, après avoir constaté l’élément matériel du crime, à savoir l’illégalité du lotissement, la confiscation est appliqué de manière légitime.
100. Le Gouvernement observe que la Convention n’impose pas qu’il y ait un lien nécessaire entre accusation en matière pénale et répercussions sur les droits patrimoniaux, à savoir rien n’empêche d’adopter des mesures de confiscation même si on les classe comme sanctions pénales résultant d’un acte qui n’a pas entraîné l’inculpation du sujet, étranger à la procédure pénale (n’ayant pas fait l’objet d’accusation pendant la procédure pénale). Sur ce point, le Gouvernement se réfère à trois arrêts de la Cour (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, série A no 108, Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, série A no 316-A et Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, CEDH 2005-VI) et observe que dans ces affaires, les requérantes avaient subi la confiscation de leurs biens même si l’accusation pénale ne portait par contre eux et ils n’avaient commis aucune faute.
101. Selon le Gouvernement, la confiscation pourrait s’analyser en une « mesure de sûreté patrimoniale » relevant de l’article 240 du code pénal, deuxième alinéa, point 2. Cette disposition indique que « le juge ordonne toujours la confiscation des choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation constitue une infraction pénale, même s’il n’y a pas eu de condamnation pénale ». Le Gouvernement observe que toute mesure de sûreté, comme toute peine, est ordonnée dans le respect du principe de légalité et renvoie à l’article 199 du code pénal, qui prévoit que « personne ne peut être soumis à des mesures de sûreté non prévues par la loi et en dehors des cas prévus par la loi ». La possibilité de confisquer les constructions abusives est prévue par l’article 240 du code pénal, 2ème alinéa, dans la mesure où ces constructions sont des « choses dont la fabrication est pénalement interdite ». Elle est également prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985. La possibilité de confisquer les sols faisant l’objet d’un lotissement abusif est uniquement prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985. En effet, les sols ne sont pas « intrinsèquement dangereux ». Le fait que la confiscation ait été ordonnée à l’égard des sociétés requérantes, tierces par rapport aux accusés, se justifie par la nature « réelle » de la sanction. Selon le Gouvernement, il n’y a pas de conflit avec le principe de « responsabilité personnelle » selon l’article 27 de la Constitution, au motif que la confiscation n’a pas une finalité répressive mais préventive. Il s’agit de rendre indisponible pour le possesseur une chose dont on présume ou on connaît la dangerosité, d’éviter de mettre sur le marché des constructions abusives, et d’empêcher la commission d’infractions ultérieures.
102. L’interprétation de l’article 19 de la loi no 47 de 1985 n’a pas été non plus imprévisible. A cet égard, le Gouvernement renvoie à l’abondante jurisprudence en la matière et soutient que la Cour de cassation avait déjà affirmé en 1987 (arrêt no 614 du 13 mars 1987, Ginevoli) qu’une construction autorisée mais non conforme aux dispositions sur l’urbanisme pouvait faire l’objet de saisie. En outre, l’arrêt Ligresti de 1991 de la Cour de cassation aurait affirmé que tout permis de construire doit faire l’objet d’un test de compatibilité et doit donc passer pour illicite et inexistant s’il s’avère contraire à la loi. Ensuite, le Gouvernement observe que s’il est vrai que l’interprétation judiciaire en matière pénale doit être raisonnablement prévisible, les revirements de jurisprudence constituent une matière soustraite à la juridiction de la Cour qui ne peut ni comparer les décisions rendues par les tribunaux nationaux ni interdir la possiblité d’un revirement jurisprudentiel.
103. De surcroît, le Gouvernement observe que depuis 2001 (décret législatif no 231/01), une société peut faire l’objet d’une mesure patrimoniale découlant d’un acte commis par son représentant légal.
104. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête comme étant « irrecevable et/ou mal fondée. »
3. Appréciation de la Cour
a) Rappel des principes pertinents applicables
105. La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A nos 335-B et 335-C, p. 41, § 34, et p. 68, § 32, respectivement).
106. L’article 7 § 1 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d’autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII).
107. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
108. La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996-V ; S.W. c. Royaume-Uni, § 35, 22 novembre 1995 ; Kokkinakis c. Grèce,
25 mai 1993, §§ 40-41, série A no 260-A). Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal (Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A). On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).
109. La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).
110. La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition (Murphy c. Royaume-Uni, requête no 4681/70, décision de la Commission des 3 et 4 octobre 1972, Recueil de décisions 43 ; Coëme et autres, arrêt précité, § 145).
b) L’application de ces principes dans la présente affaire
111. Dans leurs volumineuses observations, les parties se sont livrées à un échange d’arguments portant sur la « prévisibilité » du caractère abusif du lotissement litigieux ainsi que sur la prévisibilité de la confiscation au regard de l’évolution de la jurisprudence des cours nationales. La Cour n’estime pas devoir donner un compte-rendu détaillé des décisions citées dans le présent arrêt car il ne lui revient pas de juger du caractère imprevisible de l’infraction in abstracto. En effet, elle va se fonder sur les conclusions de la Cour de cassation qui, dans le cas d’espèce, a prononcé un acquittement à l’égard des representants des sociétés requérantes, accusés de lotissement abusif.
112. Selon la Haute juridiction nationale, les prévenus ont commis une erreur inévitable et excusable dans l’interprétation des normes violées ; la loi régionale applicable en combinaison avec la loi nationale était « obscure et mal rédigée » ; son interférence avec la loi nationale en la matière avait produit une jurisprudence contradictoire; les responsables de la municipalité de Bari avaient autorisé le lotissement et avaient assuré les requérantes de sa régularité ; à tout cela s’était ajoutée l’inertie des autorités chargées de la tutelle de l’environnement. La présomption de connaissance de la loi (article 5 du code pénal) ne jouait plus et, en conformité avec l’arrêt n. 364 de 1988 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 56 e) ci-dessus) et l’arrêt des Sections Unies de la même Cour de Cassation du 18 juillet 1994 n. 8154, l’élément moral de l’infraction (articles 42 et suivants du code pénal) devait être exclu puisque, avant même qu’on puisse examiner l’existence du dol ou d’une faute par négligence ou imprudence, il fallait exclure la « conscience et volonté » de violer la loi pénale. Dans ce cadre à la fois légal et factuel, l’erreur des accusés sur la légalité du lotissement était, selon la Cour de Cassation, inévitable.
113. Il n’appartient pas à la Cour de conclure différemment et, encore moins, de se livrer à des hypothèses sur les raisons qui ont poussé l’administration communale de Bari à gérer de telle manière une question aussi importante ainsi que sur les motifs du défaut d’une enquête efficace à cet égard de la part du parquet de Bari (paragraphe 37 ci-dessus).
114. Il convient donc de reconnaitre que les conditions d’accessibilité et prévisibilité de la loi, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, ne sont pas remplies. En d’autres termes, vu que la base légale de l’infraction ne répondait pas aux critères de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, il était dès lors impossible de prévoir qu’une sanction serait infligée. Cela vaut pour les sociétés requérantes, qui ont mis en place le lotissement illégal, comme pour leurs représentants, accusés au procès pénal.
115. Un ordre d’idée complementaire mérite d’être developpé. Au niveau interne, la qualification d’« administrative » (paragraphes 65-66) donnée à la confiscation litigieuse permet de soustraire la sanction dont il s’agit aux principes constitutionnels régissant la matière pénale. L’article 27/1 de la Constitution prévoit que la « responsabilité pénale est personnelle » et l’interprétation jurisprudentielle qui en est donnée précise qu’un élément moral est toujours nécessaire. En outre l’article 27/3 de la Constitution (« Les peines …. doivent tendre à la rééducation du condamné ») aurait du mal à s’appliquer à une personne condamnée sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
116. En ce qui concerne la Convention, l’article 7 ne mentionne pas expressément le lien moral entre l’élément matériel de l’infraction et la personne qui en est considérée comme l’auteur. Cependant, la logique de la peine et de la punition ainsi que la notion de « guilty » (dans la version anglaise) et la notion correspondante de « personne coupable » (dans la version française) vont dans le sens d’une interprétation de l’article 7 qui exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle (conscience et volonté) permettant de déceler un élément de responsabilité dans la conduite de l’auteur matériel de l’infraction. A défaut, la peine ne serait pas justifiée. Il serait par ailleurs incohérent, d’une part, d’exiger une base légale accessible et prévisible et, d’autre part, de permettre qu’on considère une personne comme « coupable » et la « punir » alors qu’elle n’était pas en mesure de connaître la loi pénale, en raison d’une erreur invincible ne pouvant en rien être imputée à celui ou celle qui en est victime.
117. Sous l’angle de l’article 7, pour les raisons développées plus haut, un cadre législatif qui ne permet pas à un accusé de connaître le sens et la portée de la loi pénale est défaillant non seulement par rapport aux conditions générales de « qualité » de la « loi » mais également par rapport aux exigences spécifiques de la légalité pénale.
118. Pour l’ensemble de ces raisons, il s’ensuit que la confiscation litigieuse n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 7 de la Convention. Elle s’analyse dès lors en une sanction arbitraire. Partant il y a eu violation de l’article 7 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
119. Les requérantes dénoncent l’illégalité ainsi que le caractère disproportionné de la confiscation qui a frappé leurs biens. Elles allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose dans sa partie pertinente ainsi:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…). »
A. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1
1. Thèses des parties
120. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Giannetaki E. & S. Metaforiki Ltd et Giannetakis c. Grèce, no 29829/05, §§ 15-19, 6 décembre 2007 ; Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, §§ 17 et 48, 11 janvier 2007), les requérantes soutiennent que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique en l’espèce et que la Cour peut examiner une ingérence dans le droit au respect des biens sous l’angle de cette disposition même s’il s’agit d’une peine (Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-… ; Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 50, CEDH 2001-VII). En tout cas, rien n’empêche que la Cour examine un grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il vise une législation concernant les droits patrimoniaux.
121. Pour les requérantes, la situation dénoncée s’analyse en une privation de biens, qui relève de la deuxième phrase du premier alinéa, vu que la confiscation est une peine infligée suite à l’acquittement des accusés, dans le but de priver les requérantes de leurs biens de manière définitive. Elles demandent à la Cour de considérer la situation dénoncée comme une expropriation de fait. A cet égard elles font observer que le cas d’espèce se distingue de ceux où la Cour a conclu que la confiscation découlait de la réglementation de l’usage des biens, car ici il ne s’agit pas d’une peine infligée à des tiers étrangers à un procès pénal ayant débouché sur la condamnation des coupables. En effet, il s’agit d’une peine appliquée suite à l’acquittement des prévenus (voir, a contrario AGOSI c. Royaume-Uni,
24 octobre 1986, série A no 108 ; C.M. c. France (déc.), no 28078/95, CEDH 2001-VII). Il ne s’agit pas non plus d’une mesure patrimoniale de prévention (a contrario, Arcuri c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII), mais d’une peine.
122. Pour le Gouvernement, vu que la Cour a qualifié la confiscation de sanction pénale, l’on ne peut pas spéculer sur l’application de l’article 1 du Protocole no 1. Affirmer que le principe du respect du droit de propriété devrait aussi rentrer dans le champ d’évaluation de la Cour serait comme prétendre d’évaluer la détention régulière sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, puisque par exemple la privation de liberté interdit au détenu de gagner sa propre vie, en l’empêchant de continuer à exercer son métier. On finirait par spéculer sur la proportionnalité de la réponse répressive par rapport au crime commis. D’autre part, seulement en matière de liberté d’expression la Convention s’occupe de garantir un rapport de proportionnalité entre crime et sanction ; pour le reste, la mesure de la peine ou la proportionnalité de cette dernière par rapport au crime sont hors du champ d’application de la Convention, attendu qu’il s’agit d’une matière constituant un des terrains de prédilection de la souveraineté des États contractants.
123. Par ailleurs, le Gouvernement observe qu’il s’agit de griefs identiques, et que ceci est démontré par la circonstance que les requérantes reprennent pour l’essentiel les mêmes arguments déjà avancés sous l’angle de l’article 7 de la Convention. Le Gouvernement renvoie aux considérations déjà développées sous ce chapitre.
2. Appréciation de la Cour
124. Rien dans la jurisprudence de la Cour ne donne à penser que la présente affaire doit être examinée uniquement du point de vue de l’article 7 de la Convention. Les deux droits en question ont un objet différent (cf. Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-…). En outre, rien n’empêche en principe d’examiner un grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 lorsqu’il vise une législation concernant les droits patrimoniaux (J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd,
c. Royaume Uni, no44302/02, § 60.) L’article 1 du Protocole no 1 protège des « biens », notion qui peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, il ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). Lorsqu’il y a controverse sur le point de savoir si un requérant a un intérêt patrimonial pouvant prétendre à la protection de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour est appelée à définir la situation juridique de l’intéressé (Beyeler c. Italie, précité).
125. Aux yeux de la Cour, la confiscation des terrains et des bâtiments litigieux dont les requérantes étaient propriétaires a constitué une ingérence dans la jouissance de leur droit au respect des biens. Force est de conclure que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique. Reste à savoir si cette situation est couverte par la première ou la deuxième norme de cette disposition.
126. L’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes :
« la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
127. Les requérantes se sont clairement exprimées sur la norme applicable, en demandant à la Cour d’examiner l’affaire sous l’angle de la « privation des biens ».
128. La Cour note que la présente affaire se différencie de l’affaire Agosi c. Royaume-Uni (arrêt du 24 octobre 1986, série A no108), où la confiscation a été ordonnée à l’égard de biens constituant l’objet de l’infraction (objectum sceleris), à la suite de la condamnation des prévenus, car en l’espèce la confiscation a été ordonnée à la suite d’un acquittement. Pour la même raison, la présente affaire se distingue de C.M. c. France ([déc.], no 28078/95, CEDH 2001-VII) ou d’Air Canada c. Royaume-Uni (arrêt du 5 mai 1995, série A no 316-A), où la confiscation, ordonnée après la condamnation des accusés, avait frappé des biens qui étaient l’instrumentum sceleris et qui se trouvaient en possession de tiers. S’agissant des revenus d’une activité criminelle (productum sceleris), la Cour rappelle qu’elle a examiné une affaire où la confiscation avait suivi la condamnation du requérant (voir Phillips v. the United Kingdom, no. 41087/98, §§ 9-18, ECHR 2001-VII) ainsi que des affaires où la confiscation avait été ordonnée indépendamment de l’existence de toute procédure pénale, car le patrimoine des requérantes était présumé être d’origine illicite (voir Riela et autres c. Italie (déc.), no. 52439/99,
4 septembre 2001; Arcuri et autres c. Italie(déc.), no. 52024/99, 5 juillet 2001; Raimondo c. Italie, 22 Février 1994, Série A no. 281-A, § 29) ou être utilisé pour des activités illicites (Butler c. Royaume-Uni (déc.),
no. 41661/98, 27 juin 2002). Dans la première affaire citée ci-dessus, la Cour a dit que la confiscation constituait une peine au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. 1 (Phillips, arrêt précité, § 51, et, mutatis mutandis, Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, série A no. 307-A, § 35), tandis que dans les autres affaires elle estimé qu’il s’agissait de la réglementation de l’usage des biens.
129. Dans le cas d’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la confiscation tombe dans la première ou dans la deuxième catégorie, car dans tous les cas c’est le deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui s’applique (Frizen c. Russie, no 58254/00, § 31, 24 mars 2005).
B. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1
130. Les requérantes soutiennent que la confiscation litigieuse ne repose pas sur une « base légale » au sens de la Convention. Elles renvoient à cet égard aux arguments exposés pour les besoins de l’article 7 de la Convention. Elles observent ensuite que l’administration a tiré bénéfice d’une situation illégale, alors qu’il est nécessaire de maintenir un certain degré de « sécurité juridique ». En outre, elles indiquent qu’il n’y a pas de remède national susceptible de leur faire obtenir la restitution des biens confisqués, et la situation est dès lors définitive.
131. Pour le cas où la Cour examinerait sur le terrain de la proportionnalité leur grief, les requérantes observent que l’infraction pour lesquelles elles ont été poursuivies et acquittées était de « lotissement matériel », à savoir elle impliquait l’activité de construction. La sanction infligée serait disproportionnée pour les raisons suivantes. En premier lieu, l’étendue de la sanction : seulement 15% des terrains confisqués était construite. En deuxième lieu, l’innocence des requérantes, étant donne que l’attitude du propriétaire, et notamment le degré de faute ou de prudence dont il fait preuve » doit être pris en compte (Agosi, précité, §§ 54-55 et
58-60) ; Air Canada, précité, §§ 44-46). En outre, les procédures applicables en l’espèce ne permettaient aucunement de prendre en compte le degré de faute ou de prudence des requérantes ou, pour le moins, au rapport entre la conduite des requérantes et l’infraction litigieuse. En dernier lieu, l’absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, CEDH 2005-X du 11 octobre 2005 ; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, CEDH 1999-II. Les requérantes font de surcroît observer que les autorités nationales ne sont pas intervenues au début des travaux de construction, mais ont attendu longtemps de sorte que l’impact de la confiscation qui en est résulté, à savoir le préjudice subi, est très important.
132. Le Gouvernement conteste les thèses des requérantes et observe que la confiscation visait à assurer « le bon et bien ordonné aménagement du territoire, domaine où les États jouissent d’une large marge d’appréciation ».
133. Aucune charge exorbitante ne peut être reconnue à une confiscation frappant aussi bien les constructions que les sols, construits ou pas. En effet, le lotissement abusif d’un terrain suppose une transformation urbaine, notion qui concerne la totalité du terrain et non pas seulement la partie construite. Il ne s’agit pas d’un cas de construction simple mais dans un projet impliquant aussi des ouvrages d’urbanisation primaire et secondaires (au sens de la loi no. 847/1964 et de la loi 865/1971). Si la confiscation concernait seulement la partie destinée à être construite, l’administration serait obligée à suivre le projet établi par le particulier, et l’ordre urbanistique violé ne pourrait pas être rétabli car l’administration deviendrait propriétaire seulement d’une portion du terrain et le particulier resterait propriétaire seulement des portions affectées à l’urbanisation primaire et secondaire. Par conséquent, la confiscation était proportionnée.
134. Le fait que la même municipalité qui avait délivré les permis illégitimes soit devenue propriétaire des terrains ne revêt aucune importance particulière : le patrimoine est en effet celui de la collectivité des habitants de la ville, et non pas celui des administrateurs responsables de la procédure administrative incriminée. Au demeurant, les circonstances de la cause montrent en l’espèce « que la position de l’individu face au pouvoir n’a pas été certes celle d’un particulier écrasé par un État Léviathan mais, plutôt, celle d’un particulier qui a conclu un accord contra legem (n’étant, ontologiquement, un accord contra legem rien d’autre que la rencontre entre une demande visée à obtenir quelque chose d’interdit et une réponse positive à cette demande) avec un secteur déterminé de l’État, qui a opéré au mépris de la loi et des intérêts de la collectivité.(…) », comme l’auraient reconnu les juridictions nationales.
135. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête comme étant irrecevable et/ou mal fondée.
136. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du premier alinéa de cet article n’autorise une privation de propriété que « dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa reconnaît aux États le droit de réglementer l’usage des biens en mettant en vigueur des « lois ». De plus, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III). Il s’ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52 ; Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire.
137. La Cour vient de constater que l’infraction par rapport à laquelle la confiscation a été infligée aux requérantes n’avait pas de base légale au sens de la Convention et que la sanction infligée aux requérantes était arbitraire (paragraphes 114 et 118 ci-dessus). Cette conclusion l’amène à dire que l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérantes était arbitraire et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
138. En principe, cette conclusion dispense la Cour de rechercher s’il y a eu rupture du « juste équilibre » évoqué ci-dessus (paragraphe 136
ci-dessus; voir, parmi beaucoup d’autres, Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, § 62, CEDH 2000-VI). Toutefois, compte tenu de la gravité des faits dénoncés dans la présente affaire, la Cour estime opportun de se livrer à certaines considérations sur l’équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu, en ayant présent à l’esprit qu’il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (Air Canada précité, § 36).
139. La Cour relève tout d’abord que la bonne foi et l’absence de responsabilité des requérantes n’ont pu jouer aucun rôle (a contrario, Agosi, précité, §§ 54-55 et 58-60 ; Air Canada, précité, §§ 44-46) et que les procédures applicables en l’espèce ne permettaient aucunement de prendre en compte le degré de faute ou d’imprudence ni, à tout le moins, le rapport entre la conduite des requérantes et l’infraction litigieuse.
140. Ensuite, la Cour estime que l’étendue de la confiscation (85% de terrains non construits), en l’absence de toute indemnisation, ne se justifie pas par rapport au but annoncé, à savoir mettre en conformité avec les dispositions d’urbanisme les lots concernés. Il aurait amplement suffi de prévoir la démolition des ouvrages incompatibles avec les dispositions pertinentes et de déclarer sans effet le projet de lotissement.
141. Enfin, la Cour observe que la commune de Bari – responsable d’avoir octroyé des permis de construire illégaux – est l’organisme qui est devenu propriétaire des biens confisqués, ce qui est paradoxal.
142. Compte tenu de ces éléments, il y a eu rupture du juste équilibre et violation de l’article 1 du Protocole no 1 également pour cette raison.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
143. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
144. Les requérantes ont formulé leurs prétentions en s’appuyant sur deux expertises, réalisées en 2007 par le Real Estate Advisory Group (REAG). La première expertise a établi la valeur marchande des biens confisqués ; la deuxième expertise a déterminé les coût effectivement supportés par les requérantes jusqu’à la confiscation.
145. Les prétentions des requérantes peuvent se résumer ainsi :
SUD FONDI
terrain de 59 761 mètres carrés
Valeur 2007 : 260 200 000 EUR
volume de construction 289 803,656 mètres cubes
Valeur 2007 : 14 200 000 EUR
Coûts supportés jusqu’à la confiscation
92 267 508, 49 EUR + indexation + intérêts
TOTAL RECLAMĖ
274 400 000 EUR
IEMA
un terrain de 2 717 mètres carrés,
un deuxième terrain de 1 407 mètres carrés
Valeur 2007 : 10 500 000 EUR
Volumes de construction respectifs 13 585 / 13 559 mètres cubes
Valeur 2007 : 2 800 000 EUR
Coûts supportés jusqu’à la confiscation
3 597 370, 51 EUR + indexation + intérêts
TOTAL RECLAMĖ
13 300 000 EUR + 305 920,28 EUR pour coûts prévus
MABAR
un terrain de 13 077 mètres carrés
un deuxième terrainde 6 556 mètres carrés
Valeur 2007 : 61 000 000 EUR
Volumes de construction 65 385/65 157,80 mètres cubes
Valeur 2007 : 4 200 000 EUR
Coûts supportés jusqu’à la confiscation
10 550 579,12 EUR
TOTAL RECLAMĖ
65 200 000 EUR
146. Les requérantes demandent l’exonération fiscale sur les montants que la Cour leur accordera.
147. Pour le Gouvernement, il est crucial de prendre en compte le fait que les requérantes ont demandé plus ou moins le même montant à titre d’indemnistation au niveau national, ainsi qu’au titre de la satisfaction équitable. Cette situation empêche d’allouer n’importe quelle satisfaction équitable, dont l’octroi conduirait à un résultat déraisonnable, injsute et incompatible avec l’esprit de la Convention et se traduirait en une aubaine injustifiée pour les requérantes. Le Gouvernement fait observer que la procédure en indemnisation engagée par les requérantes au niveau national est toujours pendante. Si la Cour accordait une somme aux requérantes, celles-ci pourraient être indemnisés deux fois.
148. Le Gouvernement observe ensuite que les critères indemnitaires proposés par les requérantes sont tout à fait disproportionnés et ne sont pas afférents au cas d’espèce, alors que la Cour a toujours estimé que l’État concerné est libre de choisir les moyens dont il usera pour se conformer à un arrêt qui le concerne. En outre, les requérantes demandent réparation, alors qu’elles n’ont pas respecté la théorie des « mains propres ». Tout en admettant qu’il est possible en l’espèce d’entrevoir un manque de transparence dans l’activité de l’admnistration, s’il y a co-responsabilité des requérantes ou des tiers impliqués dans la procédure administrative, cela fait l’objet de procédures nationales en cours et donc le problème devra être résolu dans ce domaine national.
149. La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour ce qui est du dommage matériel, étant donné la complexité de l’affaire et l’éventualité que les parties trouvent une forme de réparation au niveau nationale. Partant, il y a lieu de réserver cette question et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte d’un éventuel accord entre l’État défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).
B. Dommage moral
150. Les requérantes réclament une somme au titre du préjudice moral que leur aurait causé le comportement de l’État. SUD FONDI sollicite le versement de 25 000 000 EUR, tandis que IEMA et MABAR demandent respectivement 4 000 000 EUR et 6 000 000 EUR.
151. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de toute somme et reprend pour l’essentiel les arguments avancés pour le dommage matériel.
152. La Cour rappelle que l’on ne doit pas écarter de manière générale la possibilité d’octroyer une réparation pour le préjudice moral allégué par les personnes morales ; cela dépend des circonstances de chaque espèce (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 32-35). La Cour ne peut donc exclure, au vu de sa propre jurisprudence, qu’il puisse y avoir, pour une société commerciale, un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire.
153. Dans la présente affaire, la manque de cadre juridique prévisible pour la confiscation et la persistance de cette situation ont dû causer, dans le chef des requérantes ainsi que de leurs administrateurs et associés, des désagréments considérables, ne serait-ce que dans la conduite des affaires courantes des sociétés. A cet égard, on peut donc estimer que les sociétés requérantes ont subi une situation qui justifie l’octroi d’une indemnité.
154. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à chaque requérante 10 000 EUR, soit une somme globale de 30 000 EUR.
C. Frais et dépens
155. Justificatifs à l’appui, les requérantes demandent le remboursement des frais encourus dans la procédure nationale, qui s’élèvent respectivement à 202 805,38 EUR pour MABAR, 160 248, 34 EUR pour IEMA et 221 130,94 EUR pour SUD FONDI.
156. Elles sollicitent également le remboursement des frais exposés devant la Cour, s’élevant à 129 024 EUR pour MABAR, à 55 296 EUR pour IEMA et 197 202,48 EUR pour SUD FONDI, contributions sociales de 2% inclues. Les requérantes réclament en outre le remboursement des frais d’expertise à concurrence de 12 500 EUR pour MABAR, 6 500 EUR pour IEMA et 26 500 EUR pour SUD FONDI.
157. Selon le Gouvernement, abstraction faite du mal fondé du petitum demandé, les frais réclamés sont excessifs.
158. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
159. La Cour estime que la procédure pénale nationale concernait la responsabilité pénale personnelle des administrateurs des sociétés requérantes. Ces frais ne peuvent dès lors pas être remboursés. Quant aux frais concernant la procédure devant la Cour, il n’y a pas lieu de douter de la nécessité de ceux-ci ni du fait qu’ils aient été effectivement engagés à ce titre. Elle juge cependant trop élevés les honoraires totaux revendiqués. Elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de les rembourser qu’en partie.
160. Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d’allouer 30 000 EUR à SUD FONDI, 30 000 EUR à MABAR et 30 000 EUR à IEMA, soit 90 000 EUR globalement, pour les frais exposés devant la Cour.
D. Intérêts moratoires
161. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, respectivement les sommes suivantes :
(i) à la requérante SUD FONDI :
– 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et
– 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
(ii) à la requérante IEMA :
– 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et
– 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
(iii) à la requérante MABAR :
– 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et
– 30 000 EUR (trente mille euros) plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Dit, que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel ; en conséquence,
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et les requérantes à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente